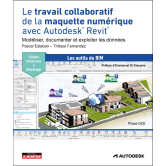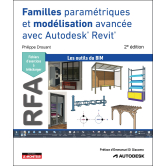Depuis le mois d’octobre, le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib) a mis sur le marché une nouvelle offre de services, Kairos, ciblée sur les gestionnaires d’ouvrages béton. Elle associe des moyens traditionnels de diagnostic (prélèvements sur site, analyses en laboratoire) à des approches novatrices de modélisation.
« Les outils numériques nous permettent de rendre compte des mécanismes physico-chimiques qui vont déterminer la durée de vie de l’ouvrage, en interaction avec son environnement. Aujourd’hui, la précision de ces modèles est accrue par la prise en compte de la quantité et de la nature des composants utilisés, de la variabilité des propriétés des matériaux et des conditions environnementales et des avancées de la recherche sur les dégradations du béton », indique Jonathan Mai-Nhu, responsable du département Durabilité des ouvrages au Cerib.
Intégrer les différentes compositions
Plus qu’un simple diagnostic, l’objectif de Kairos est donc de prédire les éventuelles dégradations du matériau. Le Cerib positionne son offre « en rupture avec les approches réactives traditionnelles de gestion des ouvrages », car basée sur des opérations de réparation mieux anticipées, et mieux maîtrisées en termes de coûts. Au cœur du réacteur, il y a le modèle numérique SDReaM-crete, outil permettant d’intégrer des mécanismes complexes de dégradations du béton et des armatures, comme le phénomène de couplage de carbonatation et de pénétration des chlorures.
Les travaux du Cerib sur la durabilité sont menés notamment à travers des thèses, dans le cadre de collaborations avec le Laboratoire matériaux et durabilité des constructions (LMDC) de l’Université de Toulouse. D’autres travaux ont fait progresser la connaissance ces dernières années, à commencer par le projet Modevie sur la modélisation au service de la santé des ouvrages, financé en partie par l’Agence nationale de la recherche, avec la participation d’une dizaine de structures publiques et privées. « Ce programme a permis de traduire les avancées des laboratoires dans un modèle exploitable par les ingénieurs, résume Thomas de Larrard, chercheur au LMDC. L’une des principales nouveautés a été d’intégrer dans les calculs les compositions des bétons, et pas seulement les bétons classiques de type CEM I avec beaucoup de clinker. »
Ne pas attendre les défauts apparents
Les nouveaux modèles peuvent donc s’appliquer à la conception d’ouvrages neufs, notamment ceux utilisant des additions minérales en forte proportion. Le Cerib a d’ailleurs expérimenté son offre Kairos sur les digues et le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral sur l’Île de la Réunion, dont il a pu justifier la durabilité du couple « formulation de béton/enrobage » dans un environnement marin agressif. Mais le principal intérêt de ces outils numériques porte sur l’entretien du patrimoine existant. En donnant aux maîtres d’ouvrage et aux bureaux d’études des éléments d'aide à la décision, il devient possible par exemple de rapprocher les inspections, d’identifier des zones plus exposées aux dégradations, ou de mieux planifier les travaux de réparation. « L’intérêt pour le maître d’ouvrage est de ne pas attendre d’avoir des défauts apparents pour engager des travaux de rénovation », résume Jonathan Mai-Nhu.
Le développement des modèles prédictifs accompagne l’évolution du marché des travaux publics, et sa bascule de la construction neuve à l’entretien. La complexité est importante pour les ouvrages construits il y a plusieurs décennies, pour lesquels l’historique de la construction n’est pas toujours disponible. Là encore, l’outil numérique apporte des solutions. « Les nouveaux modèles sont capables de simuler le comportement du béton depuis la mise en service de l’ouvrage, pour établir une probabilité d’apparition des désordres dans le futur. Ces outils pourront encore progresser ces dernières années mais on arrive déjà à obtenir de bons indicateurs pour optimiser la stratégie de maintenance », se félicite Thomas de Larrard au LMDC.