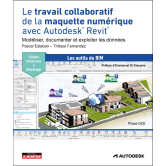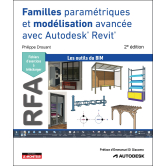« Réemployer ou recycler les matériaux déjà mis en œuvre dans les bâtiments est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire leur impact environnemental », rappelle Benjamin Laclau, ingénieur et référent économie circulaire chez Nobatek / Inef4. Mais, pour y parvenir, encore faut-il caractériser les différents éléments et réduire le coût de leur séparation. « Sans travail sur ces deux phases, la valorisation à réelle valeur ajoutée [hors incinération et remblai, NDLR] des déchets du bâtiment plafonnera à 5 % », poursuit-il.
C'est à cette tâche que s'attelle Nobatek / Inef4. Le centre de recherche appliquée participe en effet depuis le 10 décembre dernier au projet européen DigitalDeConstruction, doté d'un budget de 7,5 millions d'euros sur trois ans et fédérant une quinzaine de partenaires (1). Ce programme, qui vise à mieux organiser la déconstruction sélective, repose sur le développement d'une plate-forme d'aide à la décision au service de tous les acteurs du bâtiment : maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises de déconstruction, industriels, recycleurs…
Etablir le scénario le plus adapté. Digital, l'outil articulera une somme de technologies existantes telles que le scanner laser 3D, le building information modeling (BIM) et les bases de données relatives aux réutilisations possibles des matériaux issus de la déconstruction sélective. Il intégrera également une solution, mise au point par le Laboratory for Green Transformable Buildings de l'université du Twente (Pays-Bas), qui évaluera le potentiel de réversibilité et de démontage d'un édifice. Même la technique de la Blockchain, dans sa version développée par la start-up néerlandaise Block Materials, pourra être utilisée. De quoi donner naissance à un progiciel évolutif, car partiellement open source, qui permettra d'interconnecter toutes les données relatives aux matériaux mis en œuvre, à leur emplacement et à leur état avant d'établir le scénario de déconstruction le plus adapté.
L'outil interconnectera les données sur les matériaux, leur état et leur emplacement
Le programme de recherche se décomposera en trois temps. D'abord, une déconstruction théorique, menée avec la municipalité d'Heerlen aux Pays-Bas, qui doit définir précisément le cahier des charges. Suivront, en 2021, une dizaine d'opérations pilotes. Réparties sur sept sites à travers l'Europe, elles permettront de tester les outils numériques chacune de leur côté. Deux sites français ont déjà été retenus. Le premier est un ancien immeuble de bureaux de 500 m² du bailleur social Vilogia, à Pont-à-Marcq (Nord). Le second est la gare ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) de près de 900 m², qui sera restructurée et reconstruite. La démarche de réemploi y a déjà été lancée par l'équipe Réap d'Arep. Par ailleurs, la SNCF prévoirait également de tester la déconstruction digitale dans l'une des grandes gares parisiennes, dont le nom n'a pas été dévoilé.
Enfin, la dernière phase s'ouvrira en 2022. Les solutions seront réutilisées sur les mêmes bâtiments pilotes, avec cette fois l'objectif de rendre leurs données interopérables. Pour Benjamin Laclau, « la validation de ces outils doit également permettre la montée en compétence des différents acteurs et d'étoffer les retours d'expériences sur la déconstruction et le réemploi ». Déposés correctement, les déchets d'hier deviendront les ressources de demain.