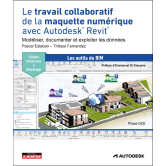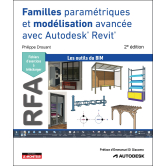L’intelligence artificielle (IA) et le deep learning font leurs preuves, dans l’analyse de la couverture des sols, mise en place par le ministère de la Transition écologique pour objectiver la mesure de l’artificialisation. Croisées avec des algorithmes, les vues aériennes fournies par l’Institut géographique national (IGN) donnent des détails précis, bientôt diffusés en accès libre par le Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).
Précision des données
« L’outil ne se contente pas de repérer le bitume. Parmi les sols plantés, il sait reconnaître les couvertures en conifères ou en feuillus », détaille Pascal Lory, directeur du dispositif de mesure de l’artificialisation des sols à la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN).
Cette finesse éclairera les rédacteurs des futurs textes réglementaires relatifs à la nomenclature du zéro artificialisation nette (ZAN). L’exercice confirme à quel point le diable se cache dans les détails, après l’annulation des premières versions par le Conseil d’Etat.
Finesse du maillage
La maille territoriale de l’occupation des sols à grande échelle (OC SGE) dépend du type d’aménagement : les polygones analysés s’étendent sur 2500 m2 dans les espaces naturels, agricoles et forestiers ; ils se resserrent sur 500 m² dans les secteurs périurbains, et 200 m² dans les surfaces bâties. Là encore, les techniciens éclairent les juristes, à qui reviendra la tâche de fixer le maillage réglementaire du ZAN.
A partir de 2021, deux expérimentations ont rodé l’outil, avec le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon (Gironde), suivi par le département du Gers. Ces tests ont permis d’affiner les algorithmes, avant le déploiement industriel, à partir de septembre 2022. « Pour mener à bien cette nouvelle étape en intégrant les remontées issues du terrain, nous avons enrichi le système avec un modèle d’annotation », précise Pascal Lory.
Système collaboratif
Indispensable pour passer de l’analyse de l’occupation à celle des usages, la collecte des données des utilisateurs des sols mobilise le logiciel Q Gis, système d’information géographique en accès libre, compatible avec un fonctionnement en plugin.
Mobilisés par les services déconcentrés de l’Etat, les utilisateurs proviennent des collectivités locales, des sociétés d’aménagement et de foncier rural, des agences d’urbanisme… Tous peuvent bénéficier d’une formation dispensée par l’IGN, pour faciliter la prise en main du système collaboratif et la remontée des signalements.
Déploiement industriel
« Du point de vue de l’IA, distinguer des surfaces enherbées ou boisées ne pose pas de problème. Le sujet devient délicat lorsqu’on aborde la question des usages, qui amène à distinguer l’enherbé agricole, celui des zones pavillonnaires ou logistiques », explique Pascal Lory. Depuis septembre 2022, le déploiement national de l’OC SGE ne cesse de confirmer cette analyse : l’expérimentation du Gers avait suscité une centaine d’annotations. Ce chiffre dépasse le millier dans certains départements.

La prise en compte des signalements précèdera la mise en ligne des premiers départements, à partir de mai. L’Ille-et-Vilaine, le Rhône et la Seine-et-Marne figureront parmi ces pionniers. A raison de trois à cinq nouveaux départements par mois, la DGALN prévoit la couverture de l’hexagone, d’ici à la fin 2024. « Entre la mise en production et la livraison, il faut compter environ neuf mois », évalue Pascal Lory.
Dédramatiser le ZAN
Parallèlement, la Martinique offre un territoire d'expérimentation, avant le déploiement industriel de l’OSGE dans l’ensemble de l’outremer. « Avec des plantes comme l’ananas ou la canne à sucre, le couvert végétal appelle des annotations spécifiques », éclaire Pascal Lory.
Balise sur la route du ZAN, l’OC SGE révèle des vertus pédagogiques. « Techniciens, aménageurs, urbanistes, voire géomaticiens, nos interlocuteurs se caractérisent par un profil plus technique que politique. Les connaissances que nous leur apportons peuvent les aider à dédramatiser le ZAN, auprès des élus », analyse Pascal Lory.