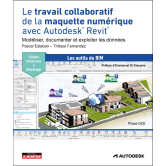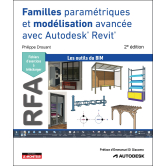« A notre connaissance, il n'existe pas d'autre jumeau numérique d'un espace naturel français », avance Fabrice Klein, chargé de l'innovation au Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB). Son service a piloté la création de Gironde XL 3D, une modélisation synchronisée de l'embouchure de la Garonne, depuis La Réole, à 50 km de Bordeaux, jusqu'à l'île de Ré. Cet outil s'inscrit dans une longue expérience de collecte de données, fondamentale pour l'exploitation de l'estuaire : le trafic des navires dépendant de la marée et de l'état du « bouchon vaseux » qui se forme à la rencontre des eaux salines et douces, neuf marégraphes et deux navires bathymétriques captent en permanence ces informations.
Le port a construit ses premiers modèles 3D à partir de 2015 pour optimiser le dragage qui lui coûte 13 M€ par an. L'établissement public a ensuite développé une plateforme d'exploitation (Lisos) hébergée dans le cloud européen : « Cela nous offre une puissance de calcul colossale », souligne Fabrice Klein. Lisos est le « moteur » des jumeaux numériques nés en 2023, qui permettent de prévoir le comportement de l'estuaire - turbidité, salinité, courants, température… - en faisant varier les critères de marées, de débit ou de météo.
Partenariat d'innovation. Au total, GPMB a mobilisé 3 M€, financés à hauteur des deux tiers par l'UE et France Relance, pour développer avec Egis un « clone » numérique dont il a vite identifié « l'intérêt pour tout le territoire ». C'est pourquoi de nombreux organismes publics - l'agence de l'eau, le Cerema, VNF ou encore l'OFB - se sont associés via un partenariat d'innovation. Et pourquoi « toute l'architecture informatique sous-jacente est en open source », insiste Fabrice Klein.
Plusieurs bureaux d'études s'en sont saisis : TEO pour suivre la dérive des plastiques dans la Gironde et identifier les zones d'accumulation, Artelia et Aventa afin d'étudier la houle - le premier pour l'implantation d'un parc éolien marin au large d'Oléron, le second pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le golfe de Gascogne. Les simulations ont duré respectivement cinq et trois semaines au lieu d'un an d'observation.
De nombreuses autres applications sont possibles : l'utilisation de l'énergie osmotique (différence de salinité) pour la production d'électricité, la connaissance des trajectoires des larves de poissons, des hydrocarbures et même… des noyés. « Nous pouvons également étudier l'impact des rejets d'eau chaude liés à des projets géothermiques ou du puisage de grandes quantités d'eau pour des besoins industriels », complète Fabrice Klein.
Les jumeaux numériques permettent de mieux anticiper l'avenir, avec des connaissances précieuses « en prévision d'éventuels conflits d'usage de l'eau », met-il en avant. Reste à créer leurs frères en amont jusqu'à Toulouse et aux Pyrénées.