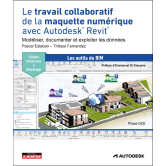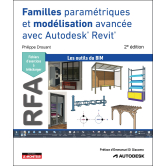Lorsque nous avons lancé en 2024 un groupe de travail sur le jumeau numérique territorial (JNT), il a tout de suite mobilisé plus d'une centaine de spécialistes, alors qu'en général, au sein du projet national MINnD dédié aux infrastructures ou de l'association BuildingSmart France (BSF), ces groupes comptent en général moins d'une dizaine de personnes, commente Maud Guizol, présidente de BSF et directrice construction numérique du groupe Colas. « Si le concept de JTN est récent, l'activité qui consiste à comprendre un territoire est aussi vieille que la cartographie », nuance Rémi Montorio, chef d'équipe expertise 3D et BIM à la Métropole européenne de Lille (MEL). L'engouement actuel s'explique donc aussi par les nouvelles capacités des logiciels à traiter une grande quantité d'information et par la convergence entre les données des systèmes d'information géographiques (SIG) et du BIM. Convergence perceptible depuis le partenariat noué en 2017 entre Esri, spécialiste du SIG, et Autodesk, éditeur de logiciels pour la construction, dont Revit. « A l'époque, je ne trouvais pas d'outils disponibles pour agréger l'ensemble de nos données au sein de Colas, reprend Maud Guizol. Nous avons donc créé un data lake, qui regroupe une grande variété de formats, puis mis au point notre proof of concept baptisé “2IN” [prononcez twin, NDLR]. Testé pendant deux ans, il a été lancé mi-2023 [lire p. 23, NDLR]. » En 2024, une dizaine d'acteurs, dont l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), mais surtout de nombreux éditeurs de logiciels, comme Urbs ou Dassault Systèmes, ont commencé à présenter leur plateforme de gestion de données.
Si le sujet suscite un réel intérêt, il est encore pertinent de le définir. Pour le consortium international Digital Twin, il s'agit « d'une représentation virtuelle d'entités et de processus du monde réel, synchronisés à une fréquence et une fidélité spécifiée ». Aux yeux des experts de MINnD, cette représentation doit aussi être « réaliste » avec « une architecture de services dynamiques qui reflète l'exploitation réelle ». Enfin, selon le CSTB, « le jumeau numérique permet de décrire l'évolution d'un modèle et de ses actifs au cours de leurs cycles de vie, depuis leur construction jusqu'à leur déconstruction ». « En aucun cas, sa qualité ne se juge au nombre d'usages développés », souligne le rapport de la Banque des territoires (BdT) sur le sujet (1).
Simulations d'aménagement. La question des usages est en effet primordiale. Le rapport de la BdT en hiérarchise trois. D'abord, les natifs, tels que les environnements communs de données, la visualisation 3D ou l'utilisation d'objets connectés. Ensuite, les usages stratégiques, comme les simulations d'aménagement ainsi que la gestion des risques. Enfin, les usages augmentés, comme le tourisme virtuel, la mobilité douce, la gestion du trafic routier, l'instruction des autorisations de permis de construire… Concrètement, certaines collectivités utilisent leur JNT pour estimer le potentiel de production photovoltaïque grâce au cadastre solaire ou détecter les anomalies sur les réseaux d'eau ou de chaleur. L'écoquartier de Kalasatama à Helsinki (Finlande) dispose d'un jumeau numérique pour simuler en 3D la dynamique des flux de vent, les apports solaires et les ombres portées. Le canton de Genève (Suisse) se sert de sa plateforme de données pour gérer les permis de construire, ce qui permet à l'administration de disposer de données fiables avec un délai de traitement réduit. De son côté, la MEL y puise les indicateurs destinés à piloter la sobriété foncière.
« Quelle que soit l'importance de l'entité, ce genre de projet part souvent d'une impulsion politique. » Chloé Friedlander, responsable de l'Accélérateur d'impact territorial de la Banque des territoires.
Devant cette variété d'exemples, Maud Guizol estime « que tous les acteurs depuis l'Etat jusqu'aux petites collectivités peuvent tirer profit d'un jumeau numérique territorial ». La présidente de BSF préconise d'ailleurs de débuter avec les données disponibles pour l'enrichir ensuite au fil des projets, sans rétro-saisie.
Un avis que ne partage pas vraiment Chloé Friedlander, copilote du rapport de la BdT, aujourd'hui responsable de l'Accélérateur d'impact territorial (BdT) : « La création et la maintenance de jumeaux numériques supposent des moyens pour gérer, structurer et mettre à jour les outils et les données qui les alimentent. Ces derniers sont souvent plus disponibles dans les collectivités de grande taille. Quelle que soit l'importance de l'entité, un tel projet part souvent d'une impulsion politique. » Jeanne Carrez-Debock, autre copilote du même rapport, qui est depuis investisseuse data, IA et confiance numérique à la BdT salue d'ailleurs l'initiative de Vendée numérique, « qui a lancé un jumeau numérique du territoire départemental, avec une approche par cas d'usage : simulation du risque de submersion, cadastre solaire et identification des zones de visibilité des éoliennes dans un premier temps. Ce projet est d'ailleurs lauréat de l'appel à projets France 2030 Démonstrateurs d'IA frugale au service de la transition écologique des territoires ».
Des démarches variées et pertinentes, à condition de mettre en place au préalable une gouvernance de la donnée : « Un facteur de réussite indispensable afin que le JNT soit réellement utile à la collectivité », insiste Rémi Montorio. Le principal frein lors de sa mise en place réside dans le choix du type de données sources, de leur qualité, de leur fiabilité et de la capacité à les partager entre des acteurs différents. « Pour chaque partage, il est nécessaire d'établir des protocoles d'échange pour déterminer quel organisme met quoi à disposition et quand. Il faut aussi décider de qui centralise ces informations. Cette masse de données n'aura de valeur que si nous sommes capables collectivement de les partager », précise l'expert de la MEL qui travaille justement à agréger des datas issues du BIM, celles des systèmes cartographiques, celles des capteurs et celles des opérateurs de téléphonie mobile, pour ensuite développer des services en lien avec la mobilité. « La mise en place d'un JNT permet de désiloter les métiers et de créer cette nécessaire transversalité, renchérit Maud Guizol. Il faut aussi que l'outil soit simple d'utilisation, ergonomique et esthétique pour donner envie de l'utiliser, aussi bien pour y stocker des données que pour s'en servir. »
Cloud souverain. Outre la collecte et le traitement de ces données, la question se pose de leur stockage sur des serveurs. La plupart des grands groupes du BTP utilisent ceux de Microsoft Azure ou Amazon Web Services qui sont à la fois économiques et fiables, mais qui posent le problème de l'accès par l'administration américaine, du fait du Patriot Act. Pour régler ce sujet de cloud souverain, il est possible d'opter pour des hébergeurs labé-lisés SecNumCloud. Enfin, dernier enjeu, et non des moindres, pour maintenir la pérennité de l'accès aux informations et garantir l'interopérabilité entre les différents formats (BIM, SIG, xls, jpeg…) les collectivités doivent éviter l'obsolescence des logiciels. S'affranchir de la dépendance vis-à-vis des éditeurs fait donc aussi partie des missions du groupe de travail de BSF.
(1) « Miroir, miroir… le jumeau numérique du territoire », Banque des territoires, juillet 2021.