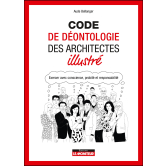Ce 2 juillet, le tunnelier Armelle de la ligne 16 du Grand Paris Express (GPE) est arrivé depuis le puits braque sur le site du projet Tulip, acronyme de « tunneliers et limitation des impacts sur les pieux », à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Il l'a quitté le 9 juillet afin de rejoindre Le Blanc-Mesnil, où il est attendu au dernier trimestre 2020. La Société du Grand Paris (SGP), en partenariat avec l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), le Centre d'études des tunnels (Cetu) et l'Université Gustave-Eiffel (UGE), a profité de son passage pour scruter le sous-sol et récolter autant de données que possible.
Une véritable opportunité car les impacts du creusement opéré par ce type d'engins sont rarement analysés dans le monde et gagneraient à être mieux connus, à plus forte raison en zones urbaines denses. La venue d'un mastodonte de plusieurs milliers de tonnes génère en effet des vibrations sur les terrains ainsi que des déformations susceptibles d'endommager les fondations des bâtiments voisins.

Site instrumenté. A Aulnay-sous-Bois, un dispositif spécifique a été mis en place pour l'occasion. Il se compose d'abord de trois pieux de mesure, bardés de capteurs installés dans le sous-sol, dans l'axe du tunnel : l'un au-dessus, et deux autres de part et d'autre. Afin de simuler le poids d'un bâtiment, une charge de 240 t a été appliquée en tête de chacun d'entre eux. Pour y parvenir, un empilement de poutres en acier a été construit. En complément, des théodolites et des cibles topographiques ont pris place près de la zone de tests. « Nous avons commencé à observer les comportements des terrains et les pieux instrumentés en février 2020. Nous continuerons encore quarante jours après le passage d'Armelle. Ce long laps de temps s'explique par la difficulté des mesures effectuées, car nous visons une précision de l'ordre de 0,3 mm », indique Charles Kreziak, référent génie civil pour la ligne 16 à la Société du Grand Paris.
Cette observation des phénomènes géologiques avait déjà été menée dans les années 2000 sur des chantiers européens, en particulier aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Toutefois, le nombre d'édifices était moins important et la nature des sols différente. Ces essais avaient débouché sur des préconisations spécifiques : la distance avec les immeubles voisins devait être deux fois supérieure au diamètre du tunnel, soit 18 m dans le cas du GPE.
Depuis, les recommandations ont été revues à la baisse : de l'ordre de 0,5 fois le diamètre du tunnel, soit 4,5 m environ dans le cas de la ligne 16. Sans ces évolutions, le Grand Paris Express n'aurait sans doute pas pu voir le jour. Et pour cause. La règle des 18 m aurait été impossible à respecter dans la métropole du Grand Paris, où 3 400 avoisinants ont été répertoriés rien que dans la zone d'influence géotechnique de la ligne 16. Parmi eux, 300 bâtiments reposent sur des fondations profondes (pieux, micropieux) susceptibles d'être déformées par le passage d'un tunnelier, et 60 se trouvent à moins de 10 m de l'axe du tunnel.
« Même si des avancées notables ont été réalisées ces dernières décennies, le sujet reste complexe. Les prévisions peuvent encore être améliorées et optimisées. Qui plus est, cet enjeu devient crucial avec la multiplication, ces dernières années, des chantiers ferroviaires dans des villes fortement peuplées », souligne Charles Kreziak. Les données collectées lors du projet Tulip seront ensuite comparées à plusieurs modèles prédictifs de comportements des tunneliers afin de les affiner.
A terme, cette expérience devrait non seulement alimenter la littérature scientifique déjà disponible sur le sujet au niveau international, mais aussi aider à la planification des tracés des futures lignes de métro 15 ouest et 18, qui seront elles aussi situées en zones urbaines denses.