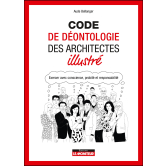Le 10 octobre dernier, le Grand Paris revenait sous les feux de l’actualité, avec une journée-bilan organisée à la Cité de l’architecture en présence du Président de la république, intitulée « Le Grand Paris, 4 ans après ». Une façon pour le chef de l’État de rappeler qu’il est à l’initiative du lancement de la réflexion autour du devenir à 20 ou 30 ans de la métropole parisienne. En septembre 2007, en effet, il innovait à sa façon : sans se préoccuper outre mesure des acteurs locaux précisément en charge de la planification de la région-capitale, il missionnait dix équipes internationales, conduites par des agences d’architectes-urbanistes épaulées par des experts et universitaires. Une première en France depuis un demi-siècle, période pendant laquelle les architectes ont été largement exclus des réflexions sur le territoire.
Après les espoirs suscités par la consultation – et l’exposition des propositions des dix équipes pendant six mois en 2009 à la Cité de l’architecture –, après le formidable écho dont a bénéficié le projet du Grand Paris à l’étranger, l’enthousiasme en France est retombé quelque peu. Le Grand Paris s’est bientôt résumé au tracé d’un métro rapide souterrain en rocade, desservant les première et deuxième couronnes, et reliant entre eux dix pôles stratégiques – surtout du point de vue économique – de l’agglomération. Un projet produit par le nouveau secrétaire d’État au Grand Paris, Christian Blanc, sourd aux propositions des architectes – qui, pour la majorité, défendaient l’idée d’un réseau de transport public en surface ou en aérien, plus générateur d’urbanité – et indifférent aux thématiques traitées : rapport ville-nature, densité et mixité, mutation et recyclage de l’existant, eau et biodiversité, identité et représentation. Les relations entre le secrétariat d’État et les équipes d’architectes resteront très épisodiques et marquées par une incompréhension rendue publique à la une du Monde du 19 mai 2010 par l’article signé Jean Nouvel : « Mais enfin, Monsieur Blanc !.. ».
Un réseau de transport souterrain
La création de l’Atelier international du Grand Paris (AIGP) début 2010, dirigé par Bertrand Lemoine, devait prolonger l’élan de la consultation – et la motivation des dix équipes d’architectes et d’urbanistes. Mais faute de moyens, celles-ci, réunies quelque peu artificiellement au sein d’un « Conseil scientifique », ont eu bien du mal à comprendre quel était désormais leur rôle. Elles ont cependant joué le jeu à l’automne 2010 en présentant une proposition commune d’un réseau de transport à l’échelle métropolitaine, puisque tel était alors l’enjeu prioritaire défini par l’État suite à la création de la Société du Grand Paris, chargée du pilotage du projet de nouveau métro rapide. La proposition de l’AIGP, en mettant l’accent sur la mise en cohérence des infrastructures existantes et à venir, a joué son rôle dans le débat public de l’hiver 2010-2011, qui a notamment conduit à rapprocher les deux projets existants, celui de l’État et celui de la Région (Arc-Express). Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, contrairement aux recommandations des architectes, le nouveau métro baptisé Grand Paris Express sera construit majoritairement en souterrain. Pour les architectes impliqués dans les études de faisabilité des premières stations (Jean-Marie Duthilleul ou Yves Lion), les enjeux portent aujourd’hui sur la profondeur des lignes, déterminant notamment l’accessibilité et l’éclairage naturel des stations. Conforté depuis juin 2011 par une nouvelle gouvernance à parité état-collectivités locales, le rôle que devra jouer l’AIGP – entre super bureau d’étude et instance de débats, de discussion, voire de validation des projets – n’est pas encore véritablement fixé.
Vers un label « Grand Paris » ?
À vrai dire, ce sont aujourd’hui les collectivités locales qui apparaissent de plus en plus motrices dans l’avancement du Grand Paris. Très vite, elles ont saisi le nouvel élan suscité par la consultation de 2008-2009 autour des problématiques territoriales, pour confier des études urbaines aux dix équipes d’architectes. Celles-ci sont aujourd’hui toutes impliquées, à des degrés divers, sur des secteurs dont l’avenir sera défini en collaboration avec l’État à travers un « contrat de développement territorial » : Duthilleul, Portzamparc et Castro sur le Bourget ; l’AUC sur Plaine Commune ; Desvigne sur Saclay mais aussi Lion sur la Cité Descartes, Leclercq sur la Défense « élargie », Geipel sur Clichy-Montfermeil et la Seine-Saint-Denis… Il existe en réalité une profusion d’études et de projets, à des échelles couvrant souvent plusieurs dizaines voire centaines d’hectares, et dont il reste malaisé de faire le recensement. Surtout si l’on y ajoute toutes les opérations urbaines ou architecturales déjà engagées avant le Grand Paris et en passe d’être livrées. L’AIGP a ainsi dénombré 650 projets existants dans les communes de la métropole parisienne. Tous sont-ils compatibles avec les principes mis en avant par les dix équipes d’architectes, principes résumés en juillet 2010 dans un petit livret « Agir sur le Grand Paris », à savoir, par exemple : lutter contre l’étalement urbain, sortir du zonage, s’appuyer sur l’existant, promouvoir la mixité, valoriser l’eau et les fleuves, travailler avec le paysage… ? Sans doute, non. Dès lors, pour éviter le fourre-tout et la banalisation, pour éviter le grand écart entre l’ambition annoncée « construire une ville-monde, rayonnante, attractive, belle et écologique »1 et sa possible traduction locale dans des projets moyens ou médiocres, ne faudrait-il pas instaurer un label « Grand Paris » ? La question prendra probablement toute sa dimension avec le renforcement des équipes d’architectes-urbanistes constituant le conseil scientifique de l’AIGP, par le lancement prochain, fin 2011, d’une nouvelle consultation internationale.