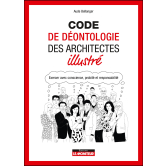Des dérogations au service d’un projet d’exception
Si l’on prête au futur Henri IV les mots « Paris vaut bien une messe » pour justifier sa conversion au catholicisme afin d’accéder au trône de France, peut-on considérer que le projet du Grand Paris « vaut bien » une conversion du droit de l’urbanisme à de nouveaux dogmes ?
Le cadre juridique dérogatoire ou spécifique posé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris doit être replacé dans le contexte normatif particulier dans lequel se trouve la région d’Ile-de-France. À de nombreuses reprises le Conseil constitutionnel a pu valider l’existence d’outils juridiques propres à celle-ci et non étendus à d’autres parties du territoire national, compte tenu de sa situation particulière en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire justifiant dès lors un traitement particulier (à propos des seuils de population dans l’application de l’, , ou de la création de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, décision n° 89-270 DC du 29 décembre 1989).
De même, il est souvent arrivé que Paris et sa région soient conçus comme une forme de laboratoire normatif et que les expériences concluantes en résultant soient ensuite étendues à l’ensemble du territoire national. C’est le cas par exemple d’une loi du 14 mai 1932 autorisant l’établissement d’un projet d’aménagement de la région parisienne auquel devaient être subordonnés les projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension des 656 communes comprises dans la région ; le principe d’une coordination supra communale fut étendu ensuite à tout le pays par une loi du 25 juillet 1935. Autre exemple : le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (Sdrif) a été le premier né des schémas régionaux, rejoint après la décentralisation de 1982 par la Corse et par les régions d’outre-mer.
Des dérogations au service d’un urbanisme de projet
Aussi peut-on légitimement se demander si le régime dérogatoire aux règles d’urbanisme de droit commun institué pour la réalisation du projet de réseau du Grand Paris préfigure le droit de l’urbanisme de demain. Pour répondre à cette question, il faut être en mesure d’analyser précisément les innovations juridiques portées par la loi du 3 juin 2010 et ses textes d’application et de voir en quoi elles sont justifiées par la réalisation du projet.
En effet, on ne peut négliger le fait que le projet du Grand Paris s’inscrit dans un contexte – porté au plus haut niveau de l’État – de discours particulièrement hostiles au droit de l’urbanisme. Au-delà donc de la nécessité de bousculer les règles pour aller vite dans un souci d’efficacité (la fin justifie les moyens), apparaît en filigrane la volonté d’initier une forme de rupture avec l’urbanisme « traditionnel » tel qu’il est figé dans sa gangue juridique (relire à ce propos l’éditorial du professeur Hugues Périnet-Marquet, Opé. Immo. n° 38, septembre 2011, p. 3).
Au regard du droit de l’urbanisme, les innovations normatives ne nous semblent pas se situer dans le mode de réalisation du réseau de transport public (débat public spécifique, qualification législative de « projet d’intérêt général » pour les projets d’infrastructures…) ou encore dans l’instauration législative d’une « zone de protection agricole et forestière » sur le plateau de Saclay (article L141-5 du code de l’urbanisme) dans laquelle les communes listées par la loi seront soumises à une servitude d’utilité publique « d’interdiction d’urbaniser ». Elles se trouvent davantage résumées par l’article 1er de la loi qui rappelle que le projet du Grand Paris « s’articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l’État, les communes et leurs groupements ». Les dispositions de la loi relatives au contrat de développement territorial (ci-après CDT – article 21) et au contrat global de mise en œuvre (article 22) ont été présentées, lors de la discussion parlementaire, comme véhiculant trois ambitions que l’on doit mettre ici en débat.